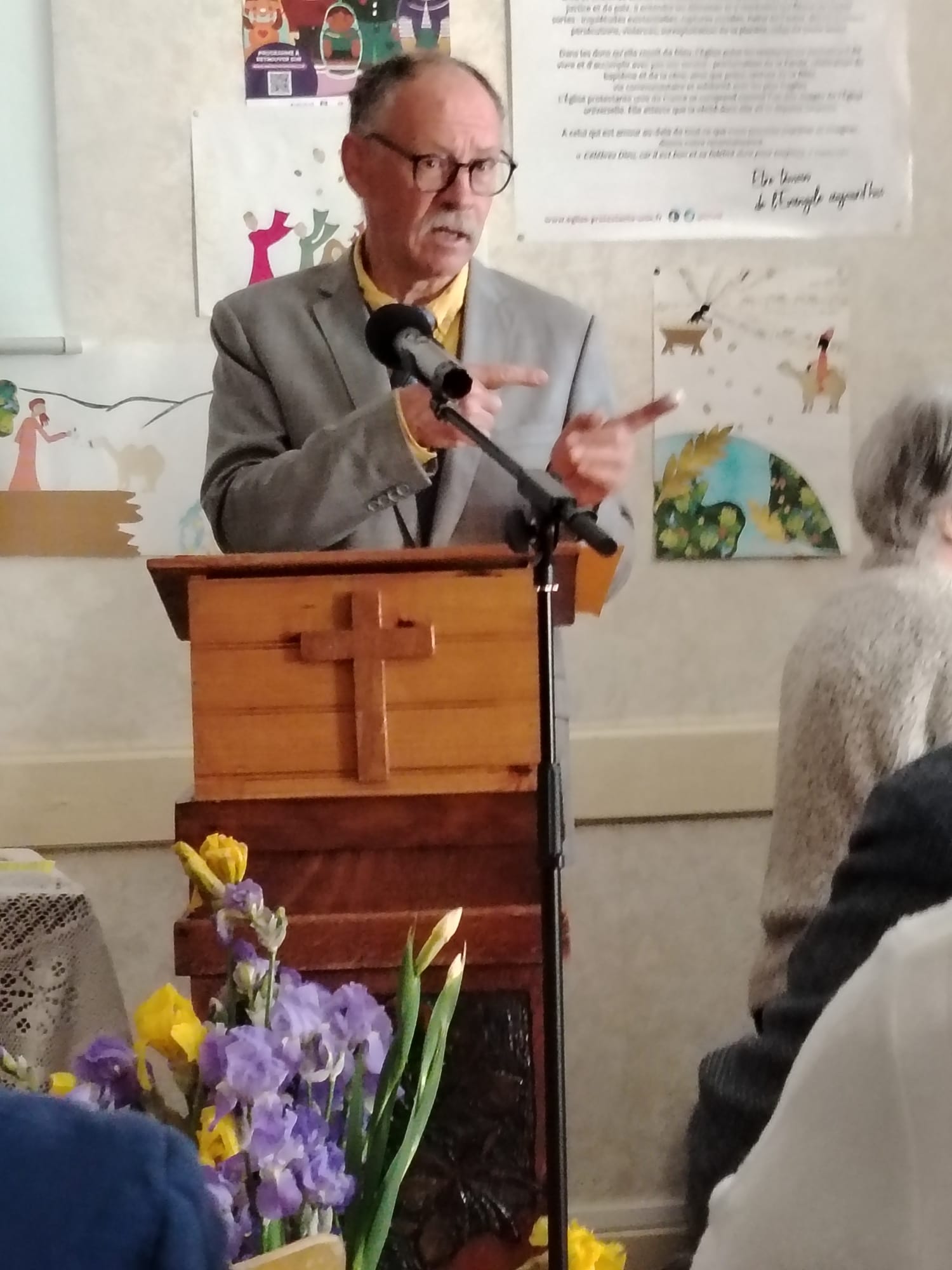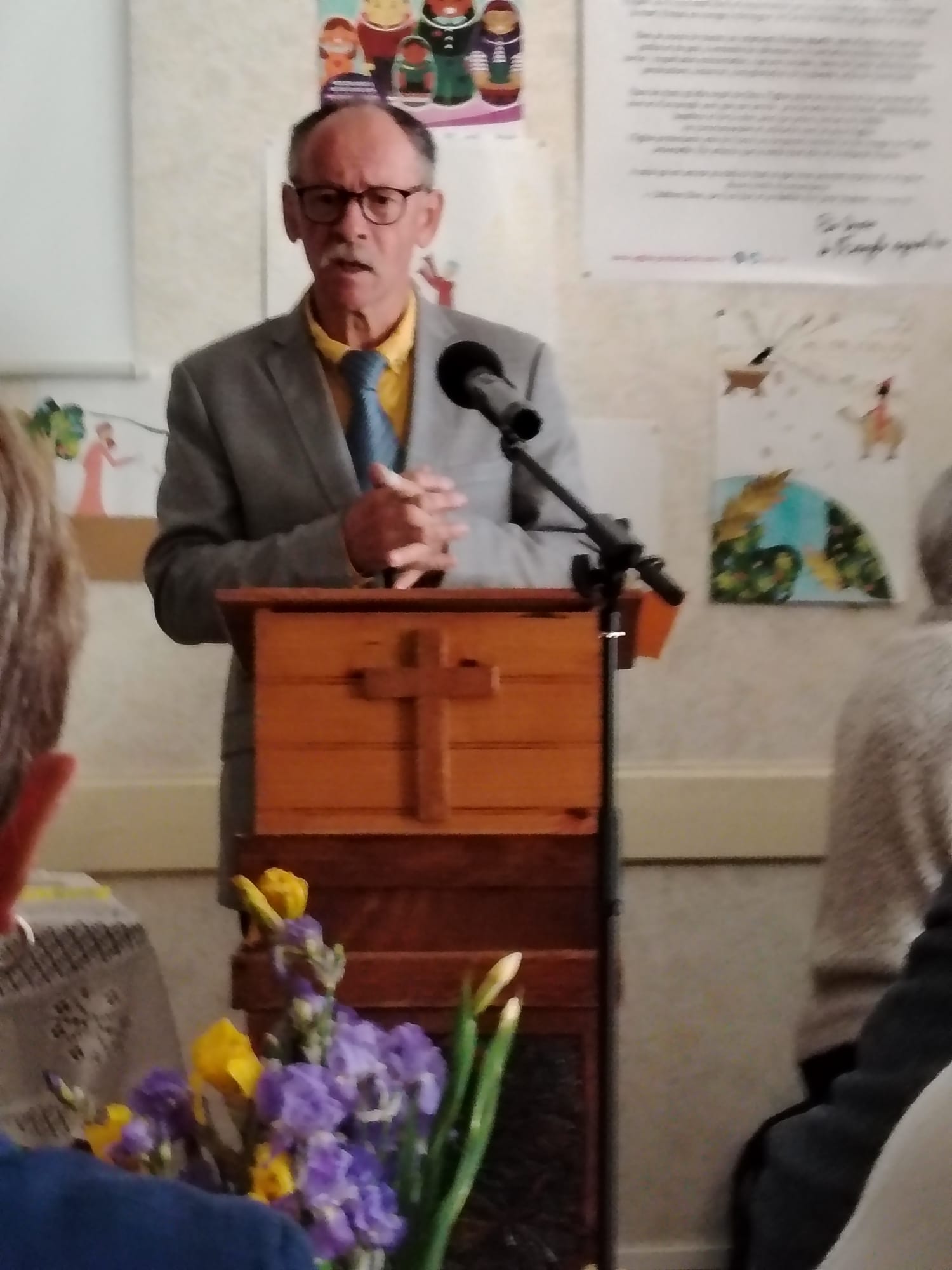À chaque fois que nous nous approchons d’un malade, d’un blessé, d’un prisonnier, d’un réfugié, d’un expulsé ou de toute autre personne malheureuse, nous nous approchons véritablement du Christ lui-même. Nous voyons le Fils qui a besoin de notre amour pour pouvoir nous manifester son amour sans limite. Dans ce cas aussi, la parabole répond à la question de l’amour du prochain. Elle nous explique que dans le malade ou le malheureux dont nous nous approchons, nous rencontrons le Christ, celui qui est venu manifester l’amour du Père pour nous.
Alors, pourquoi ai-je voulu souligner le contexte et le caractère polémique de cette parabole du bon Samaritain ?
D’abord pour vous suggérer que faire le choix de la solidarité c’est risquer de se mettre à dos les plus conservateurs dans notre société. La solidarité en actes est un combat contre l’ordre établi qui s’accommode facilement de l’injustice, de l’exclusion, de la fermeture des frontières, de l’enfermement des délinquants dans des prisons, des vieux dans les Ehpad…
Songeons à ce berger des Alpes maritimes qui était poursuivi par la justice pour avoir aidé des migrants à entrer dans notre pays… La solidarité est une attitude courageuse mais qui peut aussi devenir dangereuse. Jésus le sait bien, lui qui l’a payé de sa propre vie.
Le contexte législatif propre à la France interdit aux associations cultuelles de s’occuper d’autre chose que le culte. Les œuvres diaconales sont donc indispensables pour que les chrétiens, membres des Églises protestantes, puissent exercer ce devoir de solidarité qui leur tient à cœur. Les bons Samaritains aujourd’hui, ce sont tous les croyants qui soutiennent l’action de ces œuvres au quotidien. Ils les soutiennent soit en s’engageant comme bénévoles, s’ils en ont la possibilité, soit par leur contribution financière. Quelle que soit la forme de notre engagement, les œuvres diaconales nous permettent de nous approcher des handicapés, des personnes âgées, des sans-domicile-fixe, des migrants, des sans-papiers, des femmes battues, des malvoyants, des orphelins… et de les aider dans leur détresse. D’une certaine manière, ces œuvres agissent par délégation des croyants qui la soutiennent.
S’il me fallait trouver dans cette parabole un parallèle pour décrire le travail de ces œuvres diaconales, on pourrait dire qu’elles sont un peu comme l’hôtelier à qui le Samaritain délègue une mission de protection et d’assistance. Il lui donne déjà deux pièces d’argent et dit à l’hôtelier : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus je te le paierai moi-même. »
Si nous voulons avoir une foi équilibrée, il nous faut tenir ensemble et vivre ensemble ces deux commandements rappelés par le maître de la loi : « Tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée », et aussi : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Pour terminer, on pourrait relire cet admirable passage du livre d’Ésaïe que Jésus avait probablement en tête lorsqu’il a imaginé cette parabole :
« Voici la forme de culte à laquelle je prends plaisir [dit Dieu] : c’est libérer ceux qui sont injustement enchaînés, c’est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c’est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c’est supprimer tout ce qui les rend esclaves. C’est partager ton pain avec celui qui a faim, c’est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, c’est fournir un vêtement à celui qui n’en a pas, c’est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l’aube d’un jour nouveau. » (Ésaïe 58.5-8)
Que ce soit pour chacun de nous l’ambition d’une vie réussie. Amen